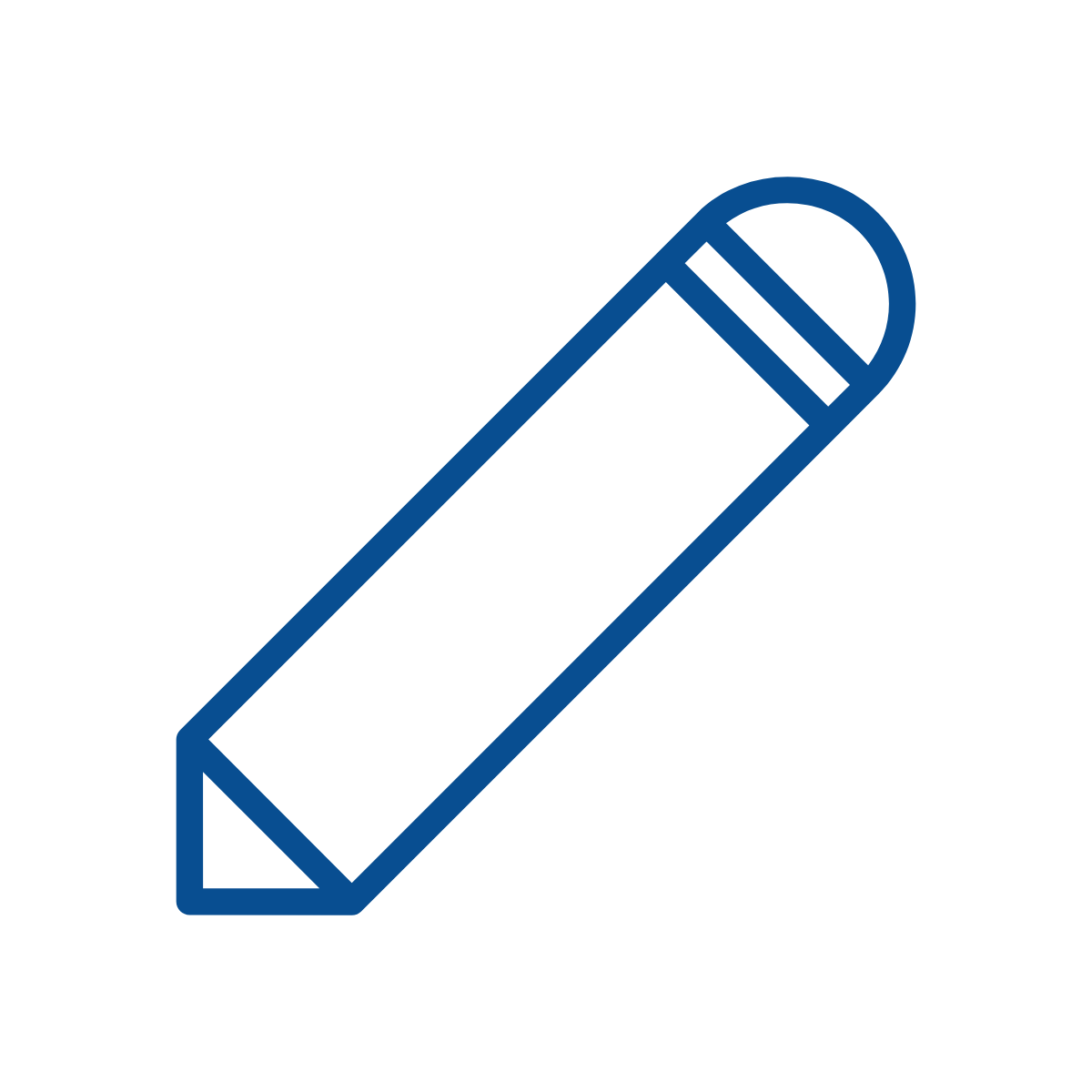-
Partager cette page
L’ours en peluche
Écomusée du Viroin (n° inv. 12257)

Fig. 1. L'ours en peluche de l'Écomusée du Viroin (n° inv. 12257)

Fig. 2. Zoom sur l'oeil de l'ours en peluche

Fig. 3. Zoom sur la patte de l'ours en peluche
L’identification
Que peut-on dire sur l’histoire de cet ours en peluche, unique représentant au sein de nos collections ? Voilà une enquête difficile.L’inventaire du musée ne nous apprend pas grand-chose. Cette peluche nous a été confiée par un habitant de Mozet (province de Namur) en 2022. Elle mesure 45cm H x 20cm L x 10cm P pour un poids de 490 grammes.
L’étude détaillée d’un certain nombre d’éléments nous renseigne toutefois un peu plus sur l’histoire de ce jouet et nous laisse supposer qu’il est assez ancien. Tout d’abord, son allure générale. Les premiers ours en peluche (1900-1930) avaient souvent un corps plus long et des membres plus allongés que nos modèles actuels, car les fabricants voulaient que leur peluche se rapproche autant que possible de la physionomie des ursidés.

Fig. 4. L’ours « 55 PB » de Richard Steiff, l’un des tout premiers ours en peluche (1902)
Le nez pointu cousu main avec sa broderie noire pour figurer la bouche (presque disparue sur notre modèle), les yeux en verre coloré, les coussinets des pattes en coton, la fourrure en laine de mohair sont également typiques de nombreux modèles de peluche du début du XXe siècle.
Ensuite, le fait que cette peluche soit articulée grâce à un système de disques en carton renforce le soupçon d’une peluche des années 1920-1930. L’observation, à la patte droite, d’une déchirure laissant apparaître le rembourrage en laine de bois finit de confirmer la période escomptée : ce type de rembourrage, majoritairement utilisé entre 1900 et 1920, sera remplacé après 1930 par la fibre de kapok par la plupart des fabricants.
Nous avons déterminé la période de fabrication de notre ours en peluche, mais qu’en est-il du fabricant ?
Lorsque l’étiquette est absente – ce qui est le cas pour notre peluche –, il est difficile d’identifier précisément l’entreprise. Si plusieurs critères permettent de délimiter un périmètre, a minima d’exclure certains fabricants, nous ne sommes pas en mesure de réaliser une expertise précise. La difficulté d’identification est renforcée par le fait qu’il était courant, jusqu’à la Seconde Guerre mondiale, que le même couturier travaille pour différents fabricants.
Relativement bien conservé, cet ours en peluche de belle facture était un jouet onéreux, relativement rare en territoire rural avant la Seconde Guerre mondiale. Le prix élevé n’était pas tant dû aux matières premières utilisées (laine angora, fibre de bois, verre, etc.) qu’au temps de travail nécessaire à sa confection. Lorsqu’il était cousu à la main, il fallait compter 20 heures de travail pour un ours de 30 cm. S’il était cousu à la machine, les finitions à la main restaient nombreuses : il fallait alors compter de 6 à 8 heures pour un ours de 30 cm.
Un catalogue Pintel de 1926 indique qu’un ours en peluche coûte entre 12 francs et 30 francs suivant la taille du modèle. Il aurait fallu qu’un ouvrier agricole travaille 10 jours à cette fin exclusive pour acheter le plus petit modèle. Un ouvrier métallurgiste, avec son salaire de 10 francs par jour, aurait pu se permettre une telle dépense en économisant plusieurs mois.

Fig. 5. Ours Pintel, dans Catalogue des Grands magasins de Paris (1926)
Les premiers ours en peluche
Les premiers ours en peluche apparaissent au cours de l’année 1903. Toutefois, la paternité de l’idée est encore aujourd’hui sujette à débat. En effet, en 1903, ce n’est pas un fabricant de jouets qui décide de produire une peluche aux allures d’ours, mais deux : l’un se trouve en Allemagne, l’autre aux États-Unis. L’histoire du premier ours en peluche est donc encore aujourd’hui racontée différemment selon que l’on se trouve d’un côté de l’Atlantique ou de l’autre. Selon la version du Nouveau Monde, l’idée de commercialiser un ours en peluche aurait germé dans l’esprit d’un petit boutiquier new-yorkais d’origine russe, Morris Michtom, désireux de profiter de l’engouement médiatique suscité par un événement impliquant le président des États-Unis, Théodore Roosevelt, et un ourson. En effet, fin 1902, Théodore Roosevelt participe à une session de chasse qui s’avère infructueuse. Les rabatteurs, soucieux de satisfaire le président, lui proposent d’abattre un ourson blessé attaché à un arbre. Considérant ce geste comme « antisportif », Roosevelt refuse et demande de libérer l’animal. L’histoire fait alors l’objet d’un intense relais journalistique et de caricatures de presse. L’ourson est vite renommé « Teddy Bear », « l’ourson de Théodore ». Face à l’engouement suscité, Morris Michtom reproduit l’ourson sous forme de peluche et le vend sous le nom de « Teddy Bear ». Le jouet connait rapidement un énorme succès commercial.
Au même moment, de l’autre côté de l’Atlantique, à Giengen an der Brenz dans le Bade-Wurtemberg, Margarete Steiff, fabricante de jouets, suit les conseils de son jeune neveu, Richard, qui lui présente les croquis d’un ours qu’il a réalisés en 1894, après une visite au zoo Nil à Stuttgart.
Séduite par l’idée, elle approuve la fabrication d’un premier modèle d’ours en peluche conçu par son neveu. Le prototype, l’Ours 55 PV (55 cm debout ; P = peluche ; B = mobile) est exposé à la foire de Leipzig au printemps 1903. Il y fait sensation, notamment car il s’agit de la première peluche articulée jamais créée. Le succès est fulgurant et dépasse rapidement les frontières de l’Allemagne.
Si cette double origine nous paraît aujourd’hui très improbable, il est en réalité quasiment certain que Margarete Steiff n’a pas eu connaissance de l’épisode américain de « Teddy Bear », étant donné la manière dont l’information circulait à l’époque en Allemagne.
L’histoire des deux peluches finit par se rejoindre lorsqu’un riche Américain, Hermann Berg, achète trois mille peluches à Margarete Steiff pour les écouler sur le marché américain. Berg renomme le jouet « Friend Petzy », « mon ami Petzy ». Dès 1907, c’est plus d’un million de peluches Petzy qui sont vendues dans le monde entier.
Le succès de l’ours en peluche tient également à son caractère non genré. C’est un jouet associé à la fois aux petits garçons et aux petites filles. Ce nouveau jouet témoigne également de l’évolution du regard sur la fonction du jouet. Auparavant uniquement valorisé pour son rôle pédagogique, le jouet devient, avec l’ours en peluche, un outil qui sert au développement de l’enfant, notamment à son développement affectif.
C’est pourquoi, progressivement, l’allure des ours en peluche s’éloigne de la physionomie des ursidés. Ils deviennent plus ronds, plus courts sur pattes. Ils gagnent également en douceur et en légèreté, là où ils étaient durs et lourds en raison de l’emploi de paille de bois. L’ours en peluche se rapproche de l’aspect d’un petit bébé, au poil doux et soyeux, un véritable doudou. Cette dimension affectueuse sera renforcée par la littérature, puis le cinéma.

Fig. 6. Croquis de Richard Steiff après sa visite au zoo de Stuttgart (1894)

Fig. 7. Winnie the poe, illustration de la première édition réalisée par Ernest H Shepard (1926)
Mais pourquoi un ours ?
Nous l’avons vu, le choix de créer des ours en peluche trouve son origine dans des événements particuliers propres au début du XXe siècle. Toutefois, on peut s’interroger sur ce choix étrange de faire de ce grand carnivore de près d’une demi tonne (ours brun) le meilleur ami des enfants. Le cas de l’ours est en réalité très intéressant pour saisir la diversité du cheminement des représentations culturelles, notamment des représentations animales à travers le temps.L’ours est un animal qui fascine les êtres humains depuis des millénaires. Particulièrement vénéré en Europe de l’époque paléolithique à la fin de l’Antiquité, il est au cœur de plusieurs cultes et rites païens à travers tout le continent. Jusqu’au XIIe siècle, il est également considéré par de nombreuses cultures européennes comme le Roi de la forêt et des animaux. Sa bestialité est reconnue comme un trait positif et prestigieux. De nombreuses légendes associent des rois ou des chefs de guerre à des « fils d’ours », c’est-à-dire qu’ils sont issus du rapt et du viol d’une femme par un ours. Cette ascendance leur permet d’hériter symboliquement d’une part de la force, de la bestialité et du prestige de l’animal.
Toutefois, avec la christianisation progressive de l’Europe, l’ours, figure païenne par excellence, devient l’enjeu de critiques virulentes de l’Église. Sa force, sa violence et ses mœurs sexuelles – réputées très proches de celles des humains – inspirent de nombreux auteurs chrétiens de traités moraux pour dénoncer les vices et les péchés des Hommes. La critique est d’autant plus vive que les cultes païens et les fêtes populaires voués à cet animal sont encore très nombreux et bien visibles au sein des sociétés européennes médiévales, jusqu’au XIIe siècle.

Le combat symbolique contre la figure de l’ours est donc un enjeu important de l’Église dans le cadre de l’expansion du christianisme en Europe. Tout au long du Moyen Âge, celle-ci va mener de grandes campagnes de dénigrement afin de déchoir l’ours de son piédestal.
L’un des procédés les plus efficaces pour y parvenir fut de remplacer l’image positive de l’ours, Roi des forêts, par celle du Lion. Cet animal, absent d’Europe continentale, mais dont l’image vertueuse est malgré tout bien identifiée par les élites médiévales, est idéal. Il permet en effet aux clercs à la fois de contrôler plus facilement son image et de lui prêter les valeurs de leur choix. Il n’est en outre associé à aucun culte païen en Europe. Le Lion se voit donc attribuer de nombreuses vertus chrétiennes, souvent associées à la royauté : force, courage, générosité, fidélité, justice. Entre les VIIIe et XIIe siècles, l’Église propagera systématiquement l’image positive du « Roi Lion » tout en dévalorisant celle de l’ours.
Les théologiens chrétiens s’appuieront également sur des passages de la Bible afin d’associer systématiquement l’ours à Satan. L’animal devient l’avatar de plusieurs des sept péchés capitaux : la colère, la paresse, la gourmandise ou encore la luxure.
Enfin, les rituels païens mettant en scène des ours sont interdits et combattus vigoureusement. C’est particulièrement le cas de certaines cérémonies populaires liées à la fertilité, où il n’était pas rare que des hommes se déguisent en ours et mobilisent des jeux à caractères sexuels.
À partir du XIIe siècle, l’ours perd de sa superbe. Il devient pour beaucoup de commentateurs un animal ridicule ou une simple monture, un attribut de certains Saints. Les spectacles d’ours sont encouragés par l’Église alors qu’elle lutte contre les saltimbanques et les autres spectacles d’animaux. Muselés et enchaînés, les ours accompagnent les jongleurs et acrobates de château en château et de foire en foire. Ils amusent le public, dansent et font des tours.
L’ours gardera cette image de « comique » jusque dans la seconde moitié du XXe siècle. Il fera partie de très nombreux et très prisés spectacles de cirque, où son caractère glouton et ridicule prend le pas sur ses talents de jonglerie.

Fig. 9. L’ours, voleur de miel (1530), enluminure - Maître de François de Rohan (XVIe siècle), coll. BNF

Fig. 10. Ours muselé et son montreur, détail de « Saint Augustin, Commentaire sur l’évangile de Jean » (début XIIe siècle), coll. Bibliothèque municipale de Tour

Fig. 11. Nouveau Cirque. Les Ours comiques (Paris), affiche,1894, coll. BNF
La dégradation de son image au Moyen Âge est accompagnée par un important déclin des populations d’ours en Europe. Les ursidés sont en effet massivement chassés durant la période médiévale, tandis que leur habitat forestier est défriché. L’ours est progressivement relégué aux espaces montagneux.
Il faudra attendre la fin du XIXe siècle, avec les premières prises de conscience de l’impact humain sur la disparition de la faune sauvage, pour voir son image retrouver une aura plus positive. À partir du début du XXe siècle, l’animal est progressivement doté de caractères humains : il devient sympathique, rondelet, court sur pattes et gentiment gourmand.
Perçu désormais comme un animal inoffensif, totalement dominé par les êtres humains, il est également étroitement associé aux mondes du spectacle et du divertissement.
On comprend donc mieux pourquoi, au début du XXe siècle, plusieurs créateurs de jouets pour enfant décident de fabriquer des ours en peluche. En 1900, la figure de l’ours est nourrie par des siècles de travail symbolique qui ont permis de lui donner progressivement une image amicale. Le succès massif des ours en peluche, faisant de cet animal le meilleur ami des enfants, parachève, en quelque sorte, ce mouvement.
Cette nouvelle image positive sera intensément propagée par la littérature, la bande dessinée et, bien évidemment, les dessins animés. L’image de l’ours débonnaire et amical progresse ensuite de génération en génération et gagne l’univers mental des adultes dans la seconde moitié du XXe siècle.
Références
BARATAY, É., La Société des animaux, de la Révolution à la Libération, Paris, La Martinière, 2007.
BARATAY, É., Le point de vue animal, une autre version de l’histoire, Paris, Seuil, 2012.
HOFFMANN-SCHICKEL, K., P. LE ROUX & É. NAVET (dirs.), Sous la peau de l'ours. L'humanité et les ursidés : approche interdisciplinaire, Saint-Denis, Connaissances et Savoirs, 2017.
PASTOUREAU, M., L’ours. Histoire d’un roi déchu, Paris, Seuil, 2007.
En ligne :
https://agdm.jimdofree.com/
https://oursement-votre.com/
https://www.jouetsanciens.fr/ours-francais/